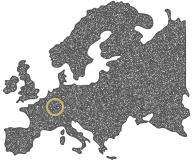Menu
Menu

Nous vivions à Keskatel, un petit village en Alsace. Quand les Allemands ont envahi la France, nous étions vraiment coincés! Non seulement étions-nous pris au milieu des bombardements, mais les Allemands nous forçaient à parler soit l’allemand ou l’alsacien.
Puis, à la fin de la guerre, la France a repris l’Alsace. Tout le monde devait de nouveau parler le français. Chose facile pour les adultes qui le parlaient déjà, mais nous, les enfants, ne l’avions pas appris…


Je m’appelle Christian Klein, et je suis né en 1938 à Strasbourg, en France. Les dix premières années de ma vie se sont déroulées dans le village de Keskatel, en Alsace.
Depuis ma naissance jusqu’en 1940, mes parents me parlaient en français. Quand les Allemands ont envahi la France, l’Alsace est devenue un territoire allemand et l’interdiction de parler le français nous a obligés à parler l’alsacien, un dialecte Suisse-allemand.
À cause de la guerre, je ne suis pas allé à l’école avant l’âge de 7 ans. Le gouvernement français nous avait envoyé des professeurs venant d’ailleurs en France pour accélérer l’apprentissage du français dans notre école. Ceux-ci étaient très sévères et nous punissaient si nous osions parler l’alsacien. Tout le monde parlait ou comprenait l’allemand et l’alsacien; les adultes parlaient aussi le français, mais les enfants ne le parlaient pas du tout. Quand nos parents ont appris que nous subissions des coups aux mains des professeurs, ils ont forcé le gouvernement à embaucher des enseignants locaux qui maîtrisaient aussi l’alsacien.
Durant mes premières vacances d’été en 1947, mes parents m’ont envoyé en Suisse française chez mon oncle, le frère de ma mère. À la rentrée, je parlais couramment le français, mais quand j’ai parlé français à mes copains dans la cour d’école, ils ne comprenaient pas et m’ignoraient. Alors, il a fallu que je parle l’alsacien si je voulais jouer avec eux.
Notre maison n’avait pas d’eau courante, mais une pompe manuelle qu’on démarrait avec un seau d’eau. Nous avions un évier de pierre dans la cuisine. Nous chauffions au charbon. Ma mère se levait vers 6 h pour allumer le feu et chauffer l’eau pour la lessive. Nous avions une toilette derrière la cuisine, avec un seau qui servait de cuvette. Il y faisait très froid l’hiver.
Tous les jours à environ 10 h, un employé de la mairie (Biedel) sonnait une cloche pour que les gens s’assemblent et l’entendent crier les nouvelles. Puis, il se rendait à un autre point dans le village pour répéter son message.
Mon père a été mobilisé dans l’armée française en 1939 et a été fait prisonnier de guerre quand la France a capitulé. Alors, ma mère a tout de suite quitté notre village pour aller se réfugier en Suisse chez mes grands-parents. Elle a donné naissance à ma sœur durant ce temps-là. Mon père a été libéré en juin 1940, et nous sommes retournés à Keskatel.
Il n’y avait pas de pénurie de nourriture au village. Le pain local était vendu chez le boulanger du village et l’épicier vendait des légumes, le boucher la viande.
Pour le beurre, les œufs et le lait, nous achetions du fermier. Nos vêtements étaient confectionnés par les femmes : nos bas et chandails tricotés, nos chemises et pantalons cousus, et reprisés autant de fois qu’ils pouvaient servir. Le cordonnier réparait nos chaussures et elles passaient aux plus petits quand elles ne nous faisaient plus.
Après la guerre un jour, ma mère m’avait envoyé faire une course chez l’épicier. Des jeunes se trouvaient devant le magasin, et m’ont offert un carré noir, me disant que c’était du chocolat. Je ne connaissais pas le chocolat et ça ressemblait beaucoup au tabac à chiquer. J’ai donc refusé. De retour à la maison, ma mère m’a offert un carré de ces mêmes plaques noires qu’elle venait de recevoir. C’était en effet du chocolat! Quel délice!
Après la guerre, les Américains ont établi le plan Marshall, un programme de distribution de nourriture. Le gouvernement français a donc commandé des tonnes de farine « corn », qui signifie « blé » en Europe. À sa grande surprise, il a reçu un convoi de farine de maïs, ce que « corn » signifie en Amérique du Nord. Ainsi, de 1945 à 1947, les Français ont mangé du pain jaune jusqu’à épuisement des stocks.
À la fin de la guerre, beaucoup d’armes et munitions ont été abandonnées, souvent là où avait eu lieu le combat. Plusieurs enfants ont été tués ou blessés en jouant avec des munitions encore actives. Je collectionnais des balles et des obus. J’en avais des boîtes pleines. Je m’amusais à démanteler les pièces pour en sortir la poudre et faire de petits monticules que j’allumais. Un jour, j’ai allumé une allumette trop près d’un détonateur. Celui-ci est passé sous mon bras.
Je l’ai échappé bel et j’ai appris ma leçon!
Nous avons vécu une guerre de raids aériens. Dès l’arrivée des troupes alliées en Normandie, les raids aériens sont devenus de plus en plus fréquents en Alsace. Un jour, j’ai vu deux avions qui donnaient ce que je croyais être un spectacle de prouesses. Tac-tac-tac-tac-tac! Ma mère est sortie de la maison à l’épouvante, m’a pris sous son bras et nous a mis à l’abri. C’est à ce moment-là qu’elle m’a expliqué que les balles pouvaient tuer.
Quand les forces alliées ont avancé vers l’Allemagne à l’automne 1944, la tranquillité de notre village a pris un tournant dramatique. Mon père a décidé que la famille irait se réfugier chez mon parrain à Strutt, à environ 50 km dans les Vosges. Le plafond en voûte du sous-sol de sa maison était beaucoup plus résistant aux bombardements que le nôtre. Notre famille et une douzaine d’autres du village ont dû passer jusqu’à trois semaines à la fois dans la noirceur de la cave, parmi les réserves de charbon et de pommes de terre.
Les hommes avaient bloqué les fenêtres avec des troncs d’arbre pour plus de protection. Le front allemand était situé dans notre village et les bombes des Alliés tombaient jour et nuit. Même à 50 kilomètres de distance notre refuge secouait. Les enfants pleuraient doucement à chaque explosion, et leurs parents essayaient de les rassurer. Maman nous chantait des chansons dans notre petit coin, séparé par des couvertures pendues du plafond.
Je me souviens qu’après deux jours sans bombardement, ma mère avait décidé d’aller aux chambres du 2e pour dormir plus confortablement. Le 2e soir, elle nous a réveillés et nous a dit que Dieu lui avait conseillé de retourner à la cave. Le lendemain, Maman et moi sommes retournés aux chambres. Une bombe avait touché cette section de la maison et des morceaux d’obus avaient traversé les murs. L’armoire à linge avait basculé. Nous serions sûrement morts si nous n’étions pas redescendus.
Lors des accalmis, les gens tentaient de reprendre leur vie normale. Les fermiers rentraient traire leurs vaches, cuire du pain et prendre quelques œufs de leur poulailler. Les femmes faisaient la lessive dans un petit abri, et moi, je collectionnais les obus qu’on trouvait partout.
Puis, un matin, j’ai vu les soldats allemands qui couraient vers la sortie du village, boutonnant rapidement leur veston. Les Alliés attaquaient du haut de la colline! Le lendemain, les forces alliées installaient un canon antiaérien derrière la maison, et un énorme canon sur rail dans le pré devant la maison. C’était le début de la fin de la guerre!
Un camion de l’armée est passé livrer de la nourriture, et parce que Maman parlait l’anglais, elle a servi d’interprète pour tout le monde.
Dix jours après l’arrivée des Américains, mon père a voulu voir l’état de notre maison à Keskatel et pour ne pas se faire méprendre pour un franc-tireur ou un déserteur, je suis parti avec lui sur son vélo.
Pendant une pause, mon père m’a demandé de prendre sa photo. J’ai déposé mon avion sur une branche tout près et j’ai pris le cliché. Mon père n’était pas content lorsqu’il a vu les résultats. Mon avion était en plein centre de la photo et lui, presque coupé en deux! J’ai gardé cette photo jusqu’à ce jour- je l’ai toujours trouvé très belle!
Une fois rendus à la maison, nous avons fait une inspection. Une bombe avait laissé un grand trou dans le mur du grenier. Les voisins nous ont expliqué qu’un blindé allemand avait été surpris par les Américains au tournant du chemin, à environ 100 m de la maison et qu’ils avaient fait feu sans ajuster leur tir. Quand nous sommes rentrés pour de bon, nous avons bouché le trou avec une fenêtre.
Voyant leur attaque s’affaiblir dans les Ardennes, les Allemands ont décidé d’une contre-offensive pour reprendre l’Alsace et diviser les troupes alliées. En janvier 1945, l’approche des Allemands nous a fait fuir à Harskirchen, à 20 km plus loin. Tout le village suivait le canal Hart où se trouvaient les Alliés. Mes parents étaient très calmes : mon père nous tirait dans une charrette, mon frère, ma sœur et moi pendant que ma mère chantait. Il faisait très froid. La lune brillait dans un ciel sans nuage. On pouvait voir les arcs laissés par le passage des bombes qui volaient au-dessus de nos têtes. Nos parents identifiaient les bombes pour nous. Nous sommes enfin arrivés au petit matin, et pendant que mon père nous a inscrits au poste de contrôle, nous nous sommes reposés dans une tente. Après notre sieste, nous nous sommes rendus chez ma tante qui vivait dans le village. Le lendemain matin, nous avons vu le résultat des bombardements, toutes les maisons en ruine partout.
Après l’Armistice et le départ des Américains, la vie est redevenue plus ou moins normale. L’école nous obligeait d’être plus organisés dans notre routine journalière. Nous avons eu des cartes de rationnement pendant 2 ans. Nous n’avons manqué de rien, surtout avec notre grand potager. Il y avait une vigne à raisin, des pommes et des poires et des légumes. Les œufs étaient conservés dans des petites barriques dans une gelée de conservation. Nous faisions du cidre, et nous avions une chambre froide, mais pas de réfrigérateur.
Je suis venu au Canada en janvier 1968 grâce à l’onde de choc qu’avait provoqué le Général Charles de Gaulle lors de sa visite. Son exclamation « Vive le Québec libre! » nous a signalé la présence de francophones au Canada. Malheureusement, mon anglais était vraiment piteux et je ne trouvais pas de travail comme ingénieur, alors je suis retourné aux études obtenir mon certificat d’enseignement.
J’ai d’abord enseigné la géographie au secondaire en Outaouais, puis, l’année suivante, j’ai accepté un poste à Kangirsujuak (Maricourt), un village Inuit dans le nord du Québec. J’y ai rencontré ma future épouse, également professeure et Américaine d’origine. Nous avons enseigné dans plusieurs villages Inuit. Lorsque je suis devenu citoyen canadien, j’ai pris ma retraite de l’enseignement pour travailler au ministère des Affaires indiennes et du Nord, dans le district de la baie d’Hudson. Après quelques années au Québec et en Alberta, j’ai accepté un poste à Whitehorse en 1982 où ma femme et mes deux fils sont venus me retrouver. Pour nous, le Yukon, c’est chez nous.