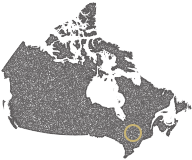Menu
Menu

Mon oncle préféré était marié à la sœur aînée de ma mère. Il était parti en guerre avant même que je sois consciente des événements mondiaux. Il a été fait prisonnier des Japonais, et n’en est jamais vraiment revenu…


Je m’appelle Marny Ryder et je suis née en 1938, à Arnprior en Ontario.
J’ai vécu l’époque de la guerre à un jeune âge. J’ai vu quatre oncles s’enrôler. Ils étaient les frères de ma mère. Le plus vieux avait passé trois ans dans un de camps de concentration japonais. Tous mes oncles ont survécu, mais n’étaient plus les mêmes à leur retour.
J’avais cinq ans quand la guerre a éclaté. Nous vivions à Arnprior en Ontario et rendions souvent visite à la parenté à Kingston. Mon oncle, ancien prisonnier de guerre, était marié à la sœur aînée de ma mère. Il était très gentil. Il était parti au front avant que je sois consciente de ce qui se passait. Il nous est revenu une loque humaine! Il fumait sans arrêt et tremblait de tout son corps. Il avait vécu la torture et la famine et son regard hanté ne montrait qu’une ombre de l’enfer qu’il avait vécu.
C’était un homme réservé qui participait peu aux fêtes de famille. Nous l’aimions beaucoup et Papa lui achetait toujours une bonne bouteille de scotch lorsqu’on allait le voir. Il devait boire beaucoup, je pense. Malgré tout, nous ne l’avons jamais vu ivre, mais toujours harcelé par ses pensées.
Heureusement, mon oncle était déjà marié à ma tante quand il est parti pour le front. Elle l’a beaucoup aidé à son retour. Au contraire de sa situation, mes oncles plus jeunes ne se sont jamais mariés, même une fois revenus au pays.
Les épreuves de mes oncles ne se comparent vraiment pas. Les plus jeunes étaient connus pour leur tendance à faire la fête! Ils buvaient peut-être, eux aussi, pour tempérer leurs propres mauvais souvenirs, reconnaissants de ne pas avoir vécu pire expérience. Qui sait ce qu’ils ont vu? Ils ont vécu le reste de leur vie sans jamais en parler, comme tant d’autres anciens combattants.
La pire des angoisses pour eux a dû être la traversée par navire de marine marchande, ce qui était très dangereux, selon mon mari Lloyd, à cause des mines et des sous-marins allemands qui sillonnaient l’Atlantique.
Lloyd et moi nous sommes rencontrés à la fin des années 60 et nous nous sommes mariés en 1969. C’était son deuxième mariage et mon premier.
Durant sa convalescence en Angleterre, il avait rencontré et épousé une Britannique. C’était en 1945 – 1946. Ils ont été mariés pendant 20 ans. Au début, il travaillait avec son père qui avait une entreprise de vente de bois. Il s’est ensuite lancé en affaire quelques années plus tard, dans la vente du fioul de chauffage. En 1965, il a décidé de devenir pilote et c'est à ce moment que je l’ai rencontré. Il exploitait sa propre entreprise de service de transport aérien. J’étais infirmière dans les communautés isolées, souvent obligée de faire transporter des patients. Le service aérien d’évacuation d’urgence médicale n’existait pas, sauf pour les petites compagnies comme celle de Lloyd. Ainsi, nous travaillions souvent ensemble. Il était déjà divorcé à ce moment-là. Il pilotait beaucoup dans la région de la chaîne des St-Elias, entre le Yukon et l’Alaska.
Je n’avais que cinq ans lorsque les soldats canadiens ont été déployés en Europe.
Mon mari, Lloyd, était beaucoup plus vieux que moi, et avait fait sa formation en génie aéronautique et mécanique, avec l’intention précise de joindre les forces de l’air. Il est né en 1922, et donc, trop jeune pour s’enrôler au début de la guerre, mais il a pu finalement le faire en 1941 – 1942. Il voulait devenir pilote et savait réparer les avions grâce à ses études, mais il a plutôt été accepté dans les forces armées, là où il y avait un plus grand besoin.
Lloyd s’est rendu en Europe juste à temps pour la reddition des Allemands. En fait, il est arrivé par navire de marine marchande seulement trois jours avant la signature de l’Armistice et a été traité en héros lors des célébrations et des défilés de victoires en Hollande. Malheureusement, il a contracté une pneumonie et a dû être transféré en Angleterre et renvoyé au Canada. Le voyage n’a pas dû être très aisé sur ces bateaux, parce que jusqu’à sa mort, mon mari a refusé d’y remettre les pieds.
Je me souviens du fameux bateau de croisière « Love Boat » qui avait amarré à Skagway. Vous n'avez pas idée à quel point je voulais le visiter! Il a refusé de m’accompagner à bord. Il refusait toutes vacances en croisière. Il aimait son bateau et le bateau-vapeur qui fonctionnait toujours à Whitehorse à l’époque, mais il refusait de monter à bord des grands bateaux.
Mon père ne s’est pas inscrit dans l’armée. Il a travaillé en tant qu’ingénieur mécanique dès sa sortie de l’université Queen’s. Nous sommes tous deux diplômés de la même université.
Tout le monde vivait le rationnement, alors il fallait être prudent et tout conserver, recycler ou transformer.
Ma sœur et moi voyions parfois le stress de nos parents, malgré leurs efforts de nous épargner.
J’ai étudié chez les religieuses catholiques. Elles étaient très conscientes des événements de la guerre. Elles nous protégeaient, elles aussi et nous imposaient beaucoup de moments de prière pour que nos soldats soient sains et saufs.
Maman et Papa étaient très dévoués à notre famille. L’information que nous, les enfants, obtenions nous parvenait de sources qu’ils utilisaient pour rester au courant des événements. Ainsi, nous avions la radio ouverte à cœur de jour, tous les jours, pour écouter les nouvelles.
Certaines choses m’ont certainement marquée, comme les chansons du temps de la guerre! La chanteuse britannique, Vera Lynn! Comme je l’adorais!
Nous ne possédions pas de voiture à ce temps-là, ou encore de télévision, mais nous avions une radio! Une Stromberg-Carlson, en boiserie fine, c’était un meuble d’envergure pratiquement aussi haut que moi! Il prenait près de la moitié de la salle de séjour!
Tous les soirs, nous nous installions pour écouter les nouvelles qui passaient sur la première chaîne radio CBC en provenance de Toronto. Nous avions promis le silence pendant les nouvelles, sous peine d’être expédiées au lit. Il y avait aussi les romans-feuilletons le soir. Nous les écoutions de nos lits et quelques-uns m’effrayaient!
Les autres formes de communication n’étaient pas encore très établies en région rurale. Les téléphones n’étaient pas fiables. Cependant, en général, cela ne nous affectait pas tellement.
Ma mère ne travaillait pas à l’extérieur. Mon père travaillait pour Kenwood Mills où l’on fabriquait des feutres pour les rouleaux d’usines à papier.
J’ai dit que nous n’étions pas vraiment concernés par la guerre, mais plus j’en parle, plus les souvenirs me reviennent. En effet, tout le monde était engagé d’une façon ou d’une autre dans l’aide aux soldats, à préparer des colis de vêtements et de vivres.
Je n’ai pas vécu de moments pénibles parce que mes parents ont tout fait pour nous protéger. Nous savions que la guerre faisait rage, bien sûr, et ma mère répondait toujours à nos questions, mais elle était très prudente dans sa façon de nous en parler. Aussi, Maman économisait en collectionnant les bons de réduction, en faisant des conserves et de l’embouteillage. À l’automne, nous entreposions la récolte dans la chambre froide. Nous avions des pommes de terre et beaucoup de légumes racines. Les étagères étaient remplies de cornichons et de sauce chili et tomate! Elle cousait aussi tous nos vêtements.
Je cultivais un jardin de la Victoire au bout de ma rue. Je l’entretenais à tous les jours avec l’aide d’un vieux couple francophone, Mère et Père Legault! Père Legault m’a tout montré pour réussir mon jardin. J’aime jardiner même aujourd’hui.
Il n’y avait pas nécessairement beaucoup de partage entre voisins, mais nous avions de la chance. Les familles plus nombreuses avaient des problèmes d’approvisionnement, mais nous vivions en milieu rural et les fermiers étaient nos fournisseurs. La viande était plus rare, mais on se débrouillait. Maman faisait souvent du pudding au pain pour ne rien perdre. Le pain dur déchiqueté, mélangé au lait, avec des raisins secs, de la cannelle, de la cassonade et un œuf.
Nous ne faisions pas d’extravagance, à cette époque, et bien que la guerre soit passée depuis longtemps, plusieurs personnes aînées ont conservé ces habitudes, sans s’en rendre compte.
Je viens de terminer une courte biographie pour l’Université Queen’s où j’ai reçu mon diplôme en sciences infirmières. C’est un profil qui a été soumis dans le cadre du 75e anniversaire de l’école.
Ils m’ont envoyé un questionnaire un peu difficile à répondre. On y demandait ce que j’avais retiré du programme. Le problème est que je n’ai pas terminé le programme de façon habituelle.
Je me suis retrouvée au Yukon après ma formation à Montréal. On m’avait demandé de prendre le territoire de Watson Lake où j’ai travaillé pendant 10 mois. J’aimais le travail, mais j’étais jeune et ma famille me manquait. Je trouvais cela très dur. Alors, je suis rentrée à Arnprior en Ontario.
Puis, moins de deux mois après mon retour, je recevais un appel de Northern Health Services. On voulait que je revienne. Alors, cette fois, je suis repartie en voiture pour me rendre à Dawson City où je suis restée 2 ans. C’est environ à ce moment-là que j’ai décidé de retourner aux études et je suis allée à l'Université Queen’s.
En arrivant à Queen’s, j’avais déjà un premier diplôme en sciences infirmières de l’hôpital général de Montréal; j’avais également travaillé dans les communautés pendant trois ans en plus d’avoir pris un an d’expérience dans un hôpital.
Je me suis retrouvée parmi des gens qui n’avaient aucune expérience. J’avais vu pas mal tout ce que la vie dans le Grand Nord pouvait faire à quelqu’un et c’était difficile de m’adapter et d’apprendre à penser. Il y avait deux types de personnes dans ce programme : celles qui étaient déjà infirmières et celles qui étaient néophytes.
Je me souviens du cours d’anglais de première année. J’avais toujours eu d’excellentes notes en anglais, pourtant, je ne réussissais pas ce cours. Le professeur était très déçu par mon travail. Mais il était patient et m’avait gentiment fait comprendre les erreurs de mon approche :
« Vous êtes une étudiante adulte. Vous êtes exactement comme les gens qui ont fait la guerre. Combien de temps consacrez-vous à étudier? » m’avait-il demandé. « Très peu. Je crois en savoir suffisamment pour agir. Ce qui doit être fait, je le fais. »
« C’est là votre erreur. » Il avait eu le même genre d’expérience et de formation, m’avait-il confié, « à présent, vous devez prendre votre temps et penser à ce que vous faites et si c’est la bonne approche. » Ce fut une adaptation difficile, mais j’ai finalement obtenu un A.
J’ai compris ce qu’il voulait dire. Si vous aviez combattu au front, ou si vous aviez travaillé en région isolée, vous faisiez face à des options limitées. Vous ne pouviez pas vraiment agir selon les meilleures approches du temps. Il fallait tenter de sauver la vie et le plus rapidement possible, selon les circonstances.
La guerre n’a jamais été ma motivation à devenir infirmière. En fait, je me suis inscrite au programme parce qu’on privilégiait les diplômées en sciences infirmières pour les emplois d’agents de bord et je voulais travailler pour CP Air afin de voyager.
Mes idéaux ont rapidement changé avec l’expérience de travail et la formation que j’ai reçues, et je me suis rendu compte qu’à part le côté éblouissant du travail d’une agente de bord, il y avait une autre réalité qui ne me convenait vraiment pas.
Au fond, je voulais plutôt faire une vraie différence dans la vie des gens.